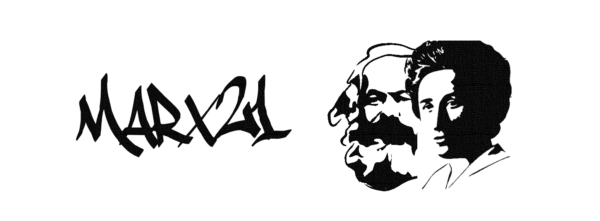Il existe, tant chez les universitaires que dans le grand public, trois points de vue sur la relation entre le capitalisme et la démocratie électorale libérale.
La première est qu’ils se soutiennent mutuellement. C’est une idée répandue chez les conservateurs. Voici ce que dit Bret Stephens, réfléchissant à Trump : « Si vous n’avez pas un exécutif qui croit en l’État de droit, qui croit au processus et aux procédures démocratiques… alors tout ce que vous espérez en matière de climat des affaires va s’effondrer… Ceux d’entre nous qui ont passé un certain temps en dehors des États-Unis savent à quel point il est essentiel de s’appuyer sur l’État de droit pour avoir une société capitaliste de libre-marché prospère, où les contrats sont ordonnés, respectés et où l’on comprend comment les choses fonctionnent. »
Bien sûr, Stephens confond l’État de droit formel wébérien avec la démocratie libérale, une erreur même sans tenir compte du dualisme d’Ernst Frankel entre le droit normal et le droit prérogatif.
Esnst Fraenkel, dans Der Dpoppelstaat, 1941, a montré que l’État nazi était fondé sur un droit dual.Il combinait un espace juridique normé (nécessaire à la stabilité économique) et un espace d’exception permanent (nécessaire à la domination politique totale) — NDT.
Mais l’argument plus général est que les libertés individuelles, ainsi que les intérêts de groupe, sont mieux protégés dans une économie de marché. Le choix est ici la clé du marché et de la politique libérale. L’histoire ne fournit pas de preuves irréfutables à l’appui de cette position.
Une deuxième opinion est que le capitalisme et la démocratie libérale sont en contradiction l’un avec l’autre, car l’inégalité des résultats produits par le marché dans le capitalisme et l’égalité supposée de toutes les personnes dans les démocraties capitalistes sont intrinsèquement opposées : l’une doit nécessairement céder la place à l’autre. Tout équilibre ne peut être que temporaire et instable.
Cette position était déjà défendue au milieu du XIXe siècle tant par les conservateurs que par les radicaux. L’historien conservateur britannique Thomas Macaulay et Karl Marx, qui ont tous deux écrit après la révolution de 1848 en France et les soulèvements chartistes en Angleterre, s’accordaient à dire que le suffrage universel pouvait détruire le capitalisme et, pour Macaulay, la liberté également. Si les masses votaient toutes, elles ne feraient que priver les nantis de leurs ressources. Pour Macaulay, une démocratie dévorerait les « semences », détruisant l’économie et, à terme, la civilisation. Pour Marx, le suffrage universel ferait progresser la démocratie et réduirait l’hyper-exploitation, même si le droit de vote seul ne suffirait pas à démanteler l’oppression de classe.

Ces points de vue découlent du fait que, comme le fait remarquer Wolfgang Merkel, le capitalisme et la démocratie obéissent à des logiques différentes : « des droits de propriété inégalement répartis d’un côté, des droits civiques et politiques égaux de l’autre ; le commerce axé sur le profit dans le capitalisme, la recherche du bien commun dans la démocratie ; le débat, le compromis et la prise de décision à la majorité dans la politique démocratique contre la prise de décision hiérarchique par les dirigeants et les propriétaires du capital ». En bref, le capitalisme n’est pas démocratique et la démocratie n’est pas capitaliste. Le niveau d’inégalité qui définit certaines variantes du capitalisme et qui est censé garantir la productivité et les profits est difficilement compatible avec le principe démocratique de l’égalité des droits et des chances en matière de participation politique.
Une troisième opinion est que la relation entre les deux est indéterminée. La question de savoir si l’inégalité des résultats du marché dans le capitalisme peut coexister avec l’égalité supposée de toutes les personnes dépend de circonstances qui ne peuvent être généralisées. Au cours des premières décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, cette perspective d’indétermination semblait convaincante. Les tensions entre les deux systèmes ont été atténuées par l’ancrage sociopolitique du capitalisme grâce à un État interventionniste en matière fiscale et sociale et à un keynésianisme axé sur la « croissance du gâteau ».
Depuis les années 1980, cependant, la financiarisation du capitalisme a rompu le compromis précaire entre capitalisme et démocratie. Les inégalités socio-économiques n’ont cessé de croître et se sont transformées directement en inégalités politiques. Le tiers inférieur des sociétés développées s’est retiré silencieusement de la participation politique ; ses préférences sont moins représentées au parlement et au gouvernement. La déréglementation et la mondialisation des marchés ont sérieusement entravé la capacité des gouvernements démocratiques à gouverner, ce qui a conduit à l’oligarchie.
Comme je l’explique ci-dessous, à l’heure actuelle, ce n’est pas une crise du capitalisme qui remet en cause la démocratie, mais son triomphe. En ce sens, la situation politico-économique actuelle est très différente de celle de l’Allemagne de Weimar, quelles que soient les continuités et les similitudes qui peuvent exister.
Le capitalisme social : l’âge d’or de la coexistence ?
Au milieu du XXe siècle, une forme de capitalisme de plus en plus organisée s’est avérée particulièrement compatible avec la politique démocratique en Europe occidentale, en Amérique du Nord et au Japon. Cela résultait des besoins favorables aux travailleurs liés à la reconstruction d’après-guerre, un point souligné par Thomas Piketty, ainsi que d’un État-providence de plus en plus expansif et interventionniste qui intervenait dans l’économie capitaliste en la régulant et en la stabilisant. Pendant cet âge d’or de la démocratie sociale, les acteurs économiques étaient multiples, réglementés et soumis à des obligations sociales. De même, des éléments de démocratie ont été introduits dans le système économique dans certains contextes, tels que la codétermination et les conseils d’entreprise.

Les concessions du capitalisme à la démocratie pendant cette période ont également été facilitées par la critique continue du capitalisme au nom de la démocratie, ainsi que par la remise en cause du modèle occidental de capitalisme par le « socialisme réel », notamment en Union soviétique. Ce n’est pas un hasard si la période de la guerre froide s’est avérée être l’apogée de la coexistence entre le capitalisme social et la social-démocratie en Europe du Nord et de l’Ouest.
Mais la croissance économique rapide des années d’après-guerre, le souvenir de la Grande Dépression et la prise de conscience des catastrophes politiques de l’entre-deux-guerres n’ont pas duré éternellement. Lentement mais sûrement, depuis les crises financières des années 1970 et l’incapacité des mouvements ouvriers à aller au-delà du compromis keynésien-social-démocrate, le capitalisme est passé de l’indétermination à ce qui ressemble à une contradiction.
À partir de Margaret Thatcher et Ronald Reagan au début des années 1980, mais aussi sous les sociaux-démocrates Clinton, Blair et Schröder, la plupart des capitalistes ont déployé des efforts incessants pour accroître la déréglementation sous la menace de grèves des investissements, de délocalisation des emplois, avec pour conséquence le chômage et une baisse du niveau de vie réel des masses. Ce virage vers la déréglementation et la mondialisation, associé à la montée de la financiarisation, a largement contribué à creuser le fossé entre capitalisme et démocratie.
Des symptômes morbides au bord du fascisme
Les démocraties électorales exigent au moins une ratification formelle par le peuple des programmes de la classe dirigeante. Cela n’est pas toujours facile à obtenir face au mécontentement populaire, car une représentation trop évidente des intérêts capitalistes peut échouer. Ainsi, aux États-Unis, ce que les républicains de l’ère Trump ont compris c’est que la redistribution flagrante vers le haut, en tant que stratégie capitaliste, ne fonctionnait plus comme alternative électorale au néolibéralisme progressiste. McCain et Romney ont finalement essuyé une défaite cuisante.
Ce que Trump a compris, ou peut-être découvert par hasard, c’est qu’il était possible de s’approprier la partie progressiste du néolibéralisme – la DEI, la soi-disant « idéologie du genre », le prétendu privilège accordé aux personnes noires et aux immigré-es — et de l’utiliser pour attiser la panique dans la classe moyenne inférieure et certaines franges de la classe ouvrière elle-même, déjà en difficulté.

Ces personnes, ainsi que celles qui ont toujours voté républicain — les républicains souffrent moins de « désalignement » que les démocrates — ont fourni une base populaire aux partisans capitalistes élitistes de Trump. Dans un certain sens, la base MAGA a donc remplacé la base démocrate, favorable à un État providence soft, comme soutien électoral privilégié d’une élite capitaliste qui s’est appuyée sur ses succès et les changements de l’économie mondiale pour devenir plus agressive et plus rapace. Ce qu’ils ont créé est ce qu’Arno Mayer a décrit non pas comme une restauration, mais comme une « contre-révolution révolutionnaire ».

Ces fractions désormais dominantes du capital proviennent à leur tour de plusieurs secteurs de la structure capitaliste : un groupe de la Silicon Valley et de Wall Street qui souhaite poursuivre l’innovation, même si elle est socialement destructrice, sans la menace d’une réglementation ; des opérateurs de fonds spéculatifs qui ont fait fortune et cherchent à éviter à tout prix l’impôt ; les conservateurs classiques anti-New Deal comme Mellon-Scaife, issus notamment des milieux des énergies fossiles, qui souhaitent détruire ce qui reste du syndicalisme et de l’environnementalisme ; et certaines fractions du capital-risque, qui se sont ralliées au premier groupe et nourrissent des utopies libertariennes de plus en plus fantaisistes de tyrannies privées décentralisées.
Ces fractions ont supplanté les capitalistes plus tolérants à l’égard de l’État providence dans les domaines industriels et publics. Les capitalistes éminents de la fraction nouvellement dominante – Thiel, Ellison, Musk, Ackman, Zuckerberg et Andreessen, pour n’en citer que quelques-uns – en sont venus à croire que seuls eux, dans leur alliance avec Trump, peuvent contenir un ennemi qui est à la fois représentatif de la décadence et de la révolution. Pendant l’entre-deux-guerres, ce sont les « judéo-bolcheviks » qui représentaient cette double menace, alors qu’aujourd’hui, il s’agit d’un mélange de gauchistes, d’écologistes, de minorités arrogantes et d’activistes anti-IA. En effet, dans une récente formulation inquiétante faisant référence à Carl Schmitt, catholique d’extrême droite et juriste du Troisième Reich, Peter Thiel les identifie collectivement comme « l’Antéchrist ».

Il n’est pas certain que ces capitalistes dominants croient ou même se soucient des déclarations économiques quasi autarciques de Trump. La vision de Trump d’une Grossraumwirtschaft, du Groenland au Canada en passant par le Panama et l’Argentine, qui implique désormais également une lutte contre le prétendu déclin démographique des Blancs, ne constitue guère une menace pour leur propre portée mondiale, que les droits de douane ne semblent pas menacer.
La République de Weimar : une nouvelle base de masse pour un capital divisé
Ces derniers mois, on a beaucoup évoqué l’Allemagne de Weimar, moment où le fascisme a d’abord menacé, puis s’est installé. Si certains aspects de notre situation rappellent Weimar, et d’autres lui font écho, de nombreux éléments sont tout simplement différents. Weimar s’est produit dans un contexte de révolution ouvrière défaite, qui a néanmoins donné naissance à un puissant mouvement social-démocrate et syndical limitant les rendements du capital ; une dépression mondiale avec un chômage sans précédent ; des millions de vétérans radicalisés et traumatisés par une guerre perdue ; des forces féodales résiduelles [les fameux Junkers, grands propriétaires terriens « féodaux », de l’Allemagne orientale, NDT] ; un revanchisme territorial ; une dépendance extraordinaire à l’égard des exportations, elle-même dépendante des prêts étrangers ; une nouvelle Constitution très progressiste mais faiblement ancrée ; et un « État profond » sérieusement régressif.

Dans le cas de Weimar, lorsque l’économie allemande et le marché international et financier dont elle était fortement dépendante ont pris un tournant difficile, après 1930, la plupart des fractions du capital se sont retirées des compromis sociaux et politiques qui avaient sous-tendu la stabilité et ont plutôt lancé des attaques féroces contre la gauche. Au sein de la classe capitaliste, la domination est passée des industries d’exportation et des industries plus modernes, moins hostiles à la main-d’œuvre, à une fraction plus à droite, protectionniste, à forte intensité de main-d’œuvre, minière et sidérurgique.
Mais il y avait un problème : peu de gens étaient prêts à voter pour des intérêts capitalistes purs et durs, et les « partis bourgeois », obéissant à leurs bailleurs de fonds, se sont affaiblis d’une élection à l’autre. Sous la pression de leurs membres et d’un mouvement communiste fort, les sociaux-démocrates et les dirigeants syndicaux ne pouvaient pas simplement abandonner les intérêts des travailleurs et attendre un autre jour pour se battre. Ils ont maintenu une défense obstinée et coûteuse des intérêts du monde du travail tant au niveau des entreprises qu’au parlement, où l’État-providence de Weimar ne pouvait être effacé.
Piégé dans une démocratie électorale, le capital allemand s’est retrouvé dans le besoin d’une nouvelle base populaire. Le compromis avec les syndicats était devenu trop coûteux et les électorats conservateurs traditionnels s’étaient fracturés et affaiblis. Ou, selon les termes d’un consultant en affaires contemporain, écrivant en septembre 1932, ce dont le capital avait besoin, c’était « de se lier à des couches sociales qui ne font pas partie de lui socialement, mais qui lui fournissent le service indispensable d’ancrer son hégémonie dans le peuple ».

La manière dont le capital allemand a trouvé ce « lien » avec le parti « Make Germany Great Again » est un sujet que j’aborde ailleurs. Ce qui est clair, en tout état de cause, c’est que l’indétermination de la relation entre capitalisme et démocratie cesse d’être indéterminée lorsque les résultats démocratiques, en période favorable ou défavorable, réduisent les profits et les prérogatives en dessous d’un certain seuil nécessaire au capital. La démocratie sera sapée et abandonnée, même si cela implique un avenir incertain.
Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, cependant, c’est que même lorsque le capital est en plein essor, récoltant des bénéfices sans précédent dans l’histoire moderne, les contraintes potentielles imposées par la démocratie peuvent constituer un fardeau trop lourd à porter. Nous devons être lucides à ce sujet. Malgré tous leurs défauts et leurs échecs, aucun politicien de Weimar défendant une démocratie capitaliste n’aurait pu se convaincre de ce que Kamala Harris a récemment affirmé quant à la relation entre le capitalisme et la démocratie : « J’ai toujours cru que si les choses tournaient mal, les titans de l’industrie seraient les gardiens de notre démocratie. »
* Cet article est paru sur le blog LPE (Law and Political Economy) Project, le 21 octobre 2025. Notre traduction de l’anglais.
David Abraham est professeur émérite de droit à l’université de Miami et l’auteur de The Collapse of the Weimar Republic: Political Economy and Crisis (L’effondrement de la République de Weimar : économie politique et crise).